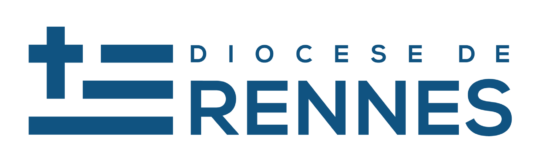Parole de l’Évêque – Église et politique
| A paraître dans Église en Ille-et-Vilaine n°364 – Juillet-août 2024 |
Message de Mgr Pierre d’Ornellas à l’occasion des élections législatives en France
Au concile Vatican II, l’enseignement de l’Église est clair : « Là où existe une société de type pluraliste, il est d’une haute importance que l’on ait une vue juste des rapports entre la communauté politique et l’Église ; et que l’on distingue nettement entre les actions que les fidèles, isolément ou en groupe, posent en leur nom propre comme citoyens, guidés par leur conscience chrétienne, et les actions qu’ils mènent au nom de l’Église, en union avec leurs pasteurs. » (Constitution Gaudium et spes, n. 76,1)
L’Église est d’abord le Peuple de Dieu qui rassemble les disciples du Christ qu’« une seule foi » et « un seul Baptême » réunissent (Ép 4,5) . Face aux tribulations de l’histoire, partageant les espoirs et les souffrances de tous (n. 1), elle est habitée par une espérance lucide qui se fait patience devant « les désordres […] qui proviennent de l’orgueil et l’égoïsme » (n. 25,3).
En effet, l’Église sait que son « Maître et Seigneur » (Jn 13,13) est « avec » elle (Mt 28,20) et que son Esprit Saint remplit les cœurs de charité (Rm 5,5). En témoignent les multiples initiatives de chrétiens qui, avec des personnes de bonne volonté en qui l’Esprit agit comme Il le fait en toute conscience droite, s’engagent avec constance et créativité, au service de leurs frères et sœurs en humanité. Ils aiment « en actes et en vérité » (1 Jn 3,8). Voilà la source de l’espérance !
Refusant la démagogie, les chrétiens n’agissent pas pour « la gloire qui vient des hommes » (Jn 12,43). Rejetant la violence verbale, ils préfèrent le « respect » (n. 27,1 ; 28,1) et le « dialogue sincère » qui permettent de chercher avec d’autres la voie la plus juste (n. 43,3 ; 68,3 ; 85,3). Ce « désir d’un tel dialogue, conduit par le seul amour de la vérité et la prudence requise, n’exclut personne » (n. 92,5). Voilà ce que devrait permettre la démocratie !
Ces disciples, citoyens de la cité humaine, s’y engagent donc, chacun selon ses forces et ses talents. Ils y reconnaissent l’humanité à laquelle tout être humain, du fait même qu’il existe, appartient, et la famille par laquelle la vie se transmet à une nouvelle personne, absolument unique, qui est accueillie et éduquée dans l’amour. L’humanité et la famille, l’homme les reçoit sans les avoir inventées. Dieu les lui confie pour qu’avec sa grâce – qui sauve de l’orgueil et de l’égoïsme – il les établisse dans la liberté et la paix, pour le bonheur de tous.
Les diverses organisations (internationales, continentales, nationales, régionales, communales, démocraties, royautés, etc) viennent de l’esprit inventif de l’être humain, pour le meilleur et pour le pire… Quoiqu’il en soit, le « chrétien », selon le beau nom des disciples de Jésus (Ac 11,26), a vocation à s’engager pour la justice, c’est-à-dire pour la non-violation de la dignité humaine en chaque citoyen, et pour la promotion de la famille en la soutenant dans sa mission éducative. Il refuse le racisme, l’antisémitisme, les conditions de vie sous-humaines, les conditions de travail dégradantes, etc (n. 27,3). Il considère les multiples aspects économiques, sociaux, culturels, éducatifs, écologiques qui sont engagés dans cette recherche de la justice.
Par son vote, le chrétien, sachant que l’idéal n’est jamais atteint par le politique, choisit parmi les programmes politiques, celui qui lui semble établir le plus de justice. Son vote blanc exprime qu’aucun ne lui paraît vraiment convenir. Mieux vaut ne pas s’abstenir.
Dans le Peuple de Dieu qu’est l’Église, les « pasteurs » – évêques et prêtres – sont les garants de la communion dans la foi au Seigneur Jésus. Écoutant ce que l’Esprit dit aux fidèles dans leur recherche de vivre selon l’Évangile, ils les guident dans l’espérance.
En effet, « l’Église qui, en raison de sa charge et de sa compétence, ne se confond d’aucune manière avec la communauté politique et n’est liée à aucun système politique, est à la fois le signe et la sauvegarde du caractère transcendant de la personne humaine. » (n. 76,2)
Pierre d’Ornellas, Archevêque de Rennes